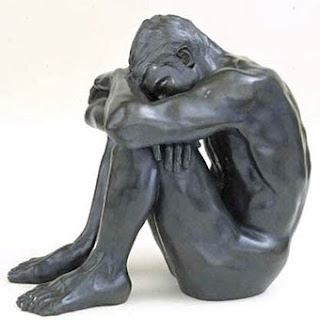Marc 7/31-37
31Il sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. 32On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler, et on le supplie de poser la main sur lui. 33Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive ; 34puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit : Ephphatha — Ouvre-toi ! 35Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia ; il parlait correctement. 36Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ils proclamaient la nouvelle. 37En proie à l'ébahissement le plus total, ils disaient : Il fait tout à merveille ! Il fait même entendre les sourds et parler les muets.
 Pour Jésus, ce dicton n’exprime pas la sagesse dont il se réclame. Il donne priorité à la parole, car c’est par la parole que Dieu se révèle et c’est par la parole que se transmet sa volonté. C’est par sa Parole nous dit la première page de la Bible que le monde fut créé. Pour être fidèle à notre Dieu nous devons être attentifs au fait que la Parole doit prendre priorité sur l’Ecrit.
Pour Jésus, ce dicton n’exprime pas la sagesse dont il se réclame. Il donne priorité à la parole, car c’est par la parole que Dieu se révèle et c’est par la parole que se transmet sa volonté. C’est par sa Parole nous dit la première page de la Bible que le monde fut créé. Pour être fidèle à notre Dieu nous devons être attentifs au fait que la Parole doit prendre priorité sur l’Ecrit. La tradition, mille fois répétée a figé les Eglises Chrétiennes dans l’ordre de l’Ecrit. On les classe parmi les religions du Livre. Les Chrétiens et en particulier les Chrétiens protestants se considèrent même comme un peuple fidèle à l'Ecriture. Ils ne sont pas forcément dans le vrai. L’Ecriture n’est qu’un support à la parole et Dieu se manifeste par la Parole et non pas par l’Ecrit.
Depuis que l’imprimerie a rendu le texte écrit accessible à tout le monde, on a tendance à croire que c’est le texte écrit qui a autorité et que la tradition n’est que le fait des peuples primitifs, sans connaissance suffisante pour écrire et lire. Au regard de Dieu il n’en est rien. C’est par le mode oral que Dieu a décidé de se manifester et de se révéler : « Dieu dit et la chose fut »
Notre propension a ne donner de valeur qu’au texte écrit a contribué à le figer et à le fixer à tout jamais sur le parchemin, le papier ou le marbre. Cette habitude nous empêche de recevoir la Parole d’une manière vivante, puisqu’elle est rendue immuable par le fait qu’elle a été fixée à tout jamais sur un support. Ainsi figée la Parole n’est plus évolutive et Dieu se trouve enfermé dans un sanctuaire de papier comme il était jadis enfermé dans un sanctuaire de pierres. On ne cherche plus à entendre Dieu autrement que par l’assimilation de textes écrits qui ont été reçus à une époque précise et qui est devenue normative pour l’éternité.
C’est au nom de ce principe que certaines églises excluent les femmes du ministère de la parole parce qu’il a paru sage de le faire, il y a 2 mille ans dans un contexte totalement différent du nôtre. La Parole ainsi figée dans le passé risque de devenir inaudible dans notre temps. C’est sur ce même principe que l’on a érigé les doctrines de l’apartheid et de la ségrégation raciale et c’est encore à partir de ce principe aujourd’hui que l’on se demande si l’on doit accueillir pleinement les homosexuels dans l’Eglise ou si l’on doit leur faire une place à part. Que d’injustices n’ont-elles pas été commises au nom du texte écrit, alors qu’on ne s’était pas donné la peine d’entendre la Parole d’une manière vivante et que l’on a préféré s’enfermer dans le texte écrit.
La vraie question est de savoir comment entendre la Parole de Dieu, tout en restant fidèle au texte écrit qui nous la transmet. Il me semble aujourd’hui que c’est sur des clivages de cette nature que se joue l’avenir du Christianisme et non pas sur les clivages hérités de l’histoire, tels que ceux qui opposent les catholiques et les protestants.
C’est sur des questions aussi importantes que celles que j’ai évoquées que se situe la portée de ce texte. Le miracle apparemment banal qui nous est rapporté ici, pose le problème de l’importance de la Parole entendue et transmise. Il place Jésus au centre de ce processus et semble nous dire qu’on ne peut entendre la Parole de Dieu que si Jésus intervient pour qu’elle devienne audible et que nous puissions ensuite la transmettre correctement.
On amène à Jésus un sourd qui a de la difficulté à parler. D’où vient-il, nul ne le sait car l’itinéraire proposé ici est trop flou pour avoir une signification géographique précise. En effet, on ne peut pas quitter Tyr et revenir par Sidon pour aller vers la mer de Galilée en traversant la Décapole. Prenez une carte, essayez d’en dégager un itinéraire, vous verrez que la chose est impossible. Cet anonyme qui vient de nulle part pourrait bien être l’un ou l’autre d’entre nous, car nous aussi nous sommes tous victimes de mauvaise audition. Si nous croyons pouvoir entendre, nous sommes la plupart du temps incapables d’écouter. Quant à notre Parole elle n’est pas toujours comprise comme nous le voudrions, il est donc souhaitable que ce qui arrive dans ce miracle à cet inconnu puisse nous arriver à nous aussi.
La suite du récit se passe dans l’intimité avec Jésus. Il le prend à part, loin des hommes et Jésus s’approprie son infirmité. Il lui met les doigts dans les oreilles et met sa propre salive au contact de sa langue. C’est sans doute un geste qui nous dégoûte un peu, mais qui nous dit clairement que Jésus s’est approprié la bouche de cet homme comme on le fait dans un baiser, aussi trivial peut être que ce que les Anglo-saxons appellent un « french kiss »
C’est alors que, pour la première fois depuis le début de ce récit que Jésus parle. Il est sobre dans ses propos, il ne donne pas un long enseignement, il prononce un seul mot : « ephphata », c’est à dire ouvre-toi. Ses yeux se tournent vers le ciel et il soupire si bien qu’on ne sait pas qui va s’ouvrir ? est-ce le ciel, les oreilles de l’infirme ou sa bouche ? Pourquoi choisir. Il est certain que la bouche et les oreilles retrouvent leur fonction, mais c’est aussi le ciel qui s’ouvre et qui est étroitement mis en relation avec la bouche et les oreilles de cet homme. En même temps qu’il peut communiquer avec les hommes il est placé dans la possibilité de communiquer avec Dieu.
Quand Jésus prend un homme en charge il le régénère complètement ! Cet homme n’est pas seulement un infirme qui retrouve les facultés dont il était privé. C’est l’être tout entier qui est mis en communication avec Dieu. Il est désormais capable d’entendre ce qui vient d’en haut, mais il est aussi capable de dire ce qu’il a entendu et de le dire clairement. Nous ne sommes plus sur le registre du miracle qui émerveille les foules et qui fait parler les bavards, nous sommes sur le registre de la conversion qui consiste à être pris en charge par Jésus pour entrer en communication avec Dieu afin que sa Parole devienne vivante.
La merveille ne réside pas dans le miracle mais dans le fait que Jésus soit capable de rétablir la communication avec Dieu. Jésus, une fois de plus, apparaît comme celui qui rend Dieu accessible.
C’est maintenant qu’il faut alors élargir la portée de ce passage et comprendre que c’est Jésus qui rend la présence de Dieu perceptible et la parole de Dieu audible. Il ouvre les oreilles de celui qui ne sait pas entendre, Il ouvre la bouche de celui qui ne sait pas parler. Il ouvre aussi les Ecritures qui prennent du sens et qui devienne vivante part sa seule présence.
Jésus se tient ainsi sur le chemin de quiconque aspire à être ouvert à Dieu. Par son souffle, il peut ouvrir le ciel, il peut ouvrir les Ecritures, il peut aussi ouvrir notre intelligence afin que la Parole Ecrite devienne une Parole de Vie. Nul ne peut s’approprier le texte biblique s’il ne prend soin, avant sa lecture, de se laisser ouvrir le cœur, l’esprit, l’oreille et l’intelligence par Jésus qui provoquera pour lui une ouverture des Ecritures qui pourront être reçues alors en plénitude comme Parole de Dieu.